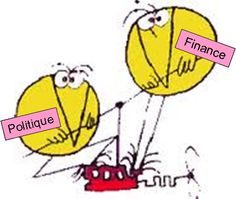Elle apparaît et disparaît
Elle apparaît et disparaît
Précédemment, nous nous sommes intéressés au pompage des liquidités. Nous avons compris que, en l’absence d’un support tangible (en pièces métalliques par exemple) ou d’une contrepartie tout aussi tangible (traditionnellement des réserves en or), elles se concrétisaient uniquement par des écritures dans des comptes tenus par les banques, sous contrôle de la banque centrale dédiée à la monnaie en question. Il suffit d’afficher une ligne de crédit sur le compte du destinataire. En raison du principe fondamental de la comptabilité en partie double, un crédit sur un compte-chèques est équilibré par une augmentation des actifs de la banque, d’une valeur nominale égale à celle de l’emprunt.
Nous avons également compris que les liquidités extraites des comptes pour permettre le déroulement des activités de l’économie réelle font tourner un genre de noria où se crée de la valeur d’usage correspondant aux productions, valeur qui est en suite détruite par leur consommation. Cette perpétuelle création de valeur pour la voir ensuite détruite est la justification des activités monétaires, car elles sont un moyen irremplaçable par lequel le volet « production » contrebalance le volet « consommation ». Elle est, de fait, la dynamique qui anime l’économie. La valeur d’usage en question, crée puis détruite, permet de satisfaire (plus ou moins correctement) les besoins ressentis par les humains.
Les liquidités sont donc un outil pour assurer tous les échanges de propriété qui se produisent lors des activités qui jalonnent ce circuit. Elles sont un faciliteur pour troquer travail humain et autres ressources afin d’obtenir en bout de chaîne, après un certain nombre d’étapes consacrées à des produits intermédiaires, un produit final ayant pour vocation de disparaître par consommation, quasi instantanément ou par usure au cours du temps.
Si les liquidités mises en circulation ont en global une valeur comptable excédant celle qui a été attribuée aux productions avant leur destruction par une consommation (leur prix), une régulation naturelle existe, l’inflation : les prix des produits augmentent pour que ces deux valeurs s’équilibrent.
Pour beaucoup, l’inflation a des inconvénients majeurs. Elle mécontente les consommateurs, elle érode la valeur constante des actifs financiers, et elle perturbe le fonctionnement du système production/consommation.
Certes, il existe une inflation saine, celle qui est causée par les investissements, qu’ils soient ou non financés par le crédit. Les liquidités qui leur sont consacrées précèdent largement celles correspondant aux productions finales qu’ils procurent, c’est le jeu du ROI (Return On Investment) Un temps pour chaque chose.
Hors investissements, le crédit à la consommation est générateur d’inflation malsaine. Il met en circulation dans la noria de l’économie réelle un surplus de liquidités. il crée un déséquilibre entre la monnaie distribuée et les quantités de produits disponibles pour consommer. Il ne peut s’envisager que dans le cadre d’une croissance régulière des rendements productifs qui contrebalancerait l’augmentation de la demande. Les emprunts étatiques ont le même effet car la redistribution ne débouche guère que sur de la consommation Diafoirus.
Pour éviter l’inflation, un moyen a été découvert expérimentalement par l’industrie financière. Il consiste à éponger toutes les liquidités qui traînent (l’épargne), pour les stocker en dehors du circuit productif. Le volume des liquidités en circulation dans l’économie réelle reste ajusté aux besoins des échanges nécessaires à la production et à la mise disposition des produits à consommer. Du point de vue comptable, il n’y-a-pas de déséquilibre. Cette industrie financière fait apparaître de la monnaie par le crédit et la fait disparaître en escamotant l’épargne. C’est de la prestidigitation. Pour les spectateurs, et même pour la plupart des prestidigitateurs en opération sur la scène, c’est surnaturel. La monnaie est-elle une réalité ou un fantôme ?
Les banques centrales sont leurrées, elles qui raisonnent à partir du volume cumulé de monnaie émise, qu’elles essayent de rapprocher de la mesure de l’inflation. Les dirigeants politiques, gros activateurs du crédit à la consommation, tant pour eux-mêmes que pour leur électorat, et qui n’ont souvent que des notions très fantaisistes des réalités comptables, le sont plus encore.
Comme pour la prestidigitation, le problème de l’industrie financière est de trouver un moyen pour entreposer dans ses accessoires (les actifs bancaires) ce qu’elle fait disparaître et elle y arrive en faisant tourner toutes ces liquidités dans une multitude de comptes.
Dans ce purgatoire, une partie des actifs va disparaître naturellement grâce à la compensation des créances par leur remboursement. Une autre partie va se volatiliser en raison du défaut de certains emprunteurs. Cependant, il reste dans la course les liquidités qui subsistent et qui correspondent aux intérêts des emprunts déjà encaissés.
Une partie va retourner vers l’économie dite réelle pour permettre la consommation des bénéficiaires de l’industrie financière (son personnel, ses fournisseurs et ses rentiers), ou pour pratiquer l’investissement productif. Ces liquidités devraient normalement être génératrices d’inflation quand la croissance de la production est trop faiblarde. Il faut alors d’autant plus absorber d’épargne afin de restreindre ce phénomène qui parasite les actifs bancaires. Dans une situation de croissance zéro, il faut essayer que le flux des liquidités escamotées équilibre tous les flux supplémentaires allant vers la consommation.
Pour l’industrie financière, il n’existe qu’un moyen d’éponger l’épargne, c’est l’emprunter aux épargnants en leur offrant un rendement financier. Cela ampute ses rentrées, mais crée une complicité commerciale entre les banques et leurs clients. Il est plus simple que les liquidités correspondant à ces rendements continuent de tourner en valeur nominale dans la marmite financière, sans aller vers la consommation et devoir être ré-escamotées. De toutes les façons, il faut offrir des rendements attractifs ce qui n’est pas léger en situation inflationniste.
Certains épargnants se chargent eux-mêmes, avec le même facteur de risque que les organismes financiers, de gérer leur épargne afin d’en tirer un rendement. Pour simplifier le raisonnement, nous allons les ranger eux-aussi dans le domaine de l’industrie financière. C’est une façon macroscopique de procéder qui n’altère en rien le raisonnement global.
Les liquidités entreposées restent donc à tourner comme véhicules pour transférer des valeurs nominales d’actifs d’un organisme à un autre. Il est nécessaire que ces transferts provoquent une plus-value destinée à couvrir les frais de l’industrie financière et de ses ayant-droits. Procéder autrement aurait entraîné une érosion des actifs et mis tout le système en difficulté.
Quand on fait le bilan des activités financières dans leur globalité, sans chercher à détailler son fonctionnement interne, elles apparaissent comme constituant une entité dont on ne considère que les entrées et les sorties (ce que l’on appelle une boîte noire dans le jargon technologique). Elles créent des liquidités (par le crédit) qu’elles injectent dans l’économie réelle. Pour éviter l’inflation, il leur est alors nécessaire de pomper un maximum de liquidités stagnantes en offrant des rendements financiers intéressants donc en suscitant des rentiers.
Si l’on compare la quantité de liquidités entrant à celle des liquidités sortant de cette boîte noire, en vertu de la comptabilité en partie double elles sont égales à une différence près, celle qui tient au délai entre la comptabilisation des dépenses et celle des recettes. C’est le jeu de ces en-cours qui permet de faire émerger une tendance inflationniste ou déflationniste. En première hypothèse, il est probable que les évolutions du volume des investissements productifs à base de crédit ont un rôle important dans le différentiel, car le retour sur investissement prend généralement plusieurs années : les dépenses correspondantes précèdent largement les recettes qu’ils procurent. Par ailleurs, il est facile de constater qu’entre l’ouverture d’une ligne de crédit (sortie de liquidités du compte de la banque) et son effacement par les dépenses de consommation de l’emprunteur (retour de liquidités de la part des vendeurs dans les comptes bancaires), il se passe en général un certain temps.
J’ignore si la valeur nominale et la composition des en-cours sont évaluées, alors je n’en dirai pas plus. Toujours est-il qu’il est indispensable pour elle que l’industrie financière assure la consommation de ses bénéficiaires car c’est en fait saseule raison d’être pour eux.
Puisque les liquidités sont constamment transférées d’un compte à un autre, et que les quantités entrant et sortant se compensent, elles ne sont pas destructibles par une consommation. Le seule grignotage de fait qui les concerne est représentée par l’inflation qui en érode leur valeur d’échange.
Toujours est-il que l’industrie financière doit créer ex nihilo de la valeur. Pour se sortir de cette impasse, il ne lui reste que l’autre façon de générer de la valeur nominale : utiliser la spéculation et la fonctionnement des bourses. Elle le fait avec une efficacité remarquable. Pour dépasser les limites de la spéculation sur des supports tangibles, elle crée des titres de toutes sortes de façons (des produits dérivés) et fait ainsi grossir ses actifs. Le problème est que, maintenant, ces actifs, en grande partie artificiels, constituent une bulle gigantesque, extrêmement fragile.
Certains pensent que, après compensation, après que les comptes aient été épurés au sein de l’industrie financière, créances des organismes entre eux face aux mouvements inverses, le solde serait négligeable.
Cela semble très douteux car la considération de la susdite boîte conduit à penser que le solde est égal au total cumulé de toutes les dépenses de consommation des bénéficiaires de l’industrie financière, acteurs et rentiers, au moins depuis que la création des monnaies par le moyen du crédit est alimentée uniquement par des jeux d’écritures comptables entre actifs artificiels. Autrement dit à partir du moment où cette création a été progressivement détachée d’une contrepartie tangible telle que l’or.
Certes, malgré une répression systémique (ou systématique, au choix du lecteur), l’inflation subsistante a fait son œuvre en rognant le valeur constante des actifs mais il doit rester un gros reliquat.
En cas de crise généralisée, la monnaie enterrée dans les méandres des transactions entre organismes financiers, sortirait de son placard et viendrait comme un fantôme titiller les vivants en les acculant à un défaut généralisé, à commencer par les plus fragiles, se répandant progressivement dans tous les pays. L’économie en général est mondialisée et l’industrie financière encore plus.
Après analyse, il apparaît donc que l’économie financière se compose de deux entités juxtaposées :
- La première, qui assure la logistique des liquidités au sein de l’économie réelle, fournit un service indispensable. Pour ajuster par le crédit le volume des liquidités utilisées en production et consommation afin de permettre la croissance (quand il y en a), le jeu des banques centrales est lui aussi indispensable. Ces activités (et les frais qu’elles provoquent) sont logiquement à inclure dans l’économie réelle. Dans ce processus, le régulateur naturel est l’inflation.
- La seconde, est l’économie spéculative. Elle crée de la valeur en faisant croître par des conventions entre acteurs internes, la valeur nominale de supports spéculatifs en grande partie artificiels. A l’observation, elle est un appendice pour permettre la consommation de ses ayant-droits. Par rapport aux activités de la production réelle, ils sont oisifs, mais leurs dépenses ont un effet inflationniste s’ajoutant à celui créé par le crédit à la consommation ou à l’investissement productif.
Remarque : C’est une analyse macroscopique à « l’emporte-pièces ». C’est logique puisqu’elle considère la manière dont la monnaie est escamotée. Si elle mérite d’être nuancée, en tant que (très petit, … hélas !) spéculateur, je suis preneur.
… à plus …